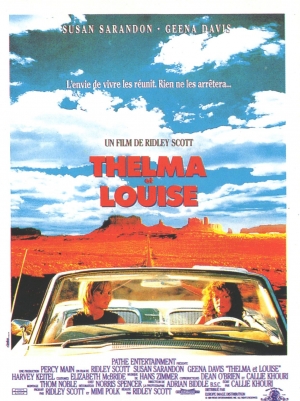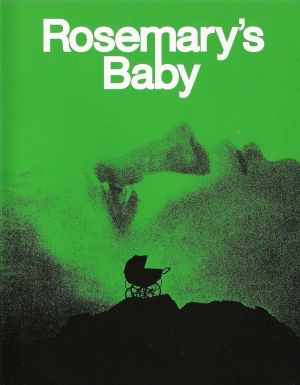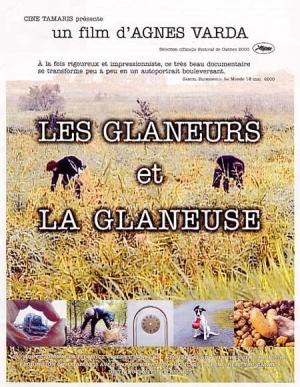Le 23/01/2019 LES CHASSES DU COMTE ZARROFF
Mercredi 23 janvier 2019 à 20h
Cinéma Juliet-Berto (Place Saint-André, Grenoble)En partenariat avec LE FESTIVAL DES MAUDITS FILMS 2019
LES CHASSES DU COMTE ZAROFF
THE MOST DANGEROUS GAME(Ernest B. Schoedsack et Irving Pichel - États-Unis - 1932 - 63 min)
. « Les Chasses du Comte Zaroff constitue, en tout état de cause,
un cauchemar à visée morale servi par une absence de sentimentalité et de pathos absolument inoubliable. »
(Jacques Lourcelles, Dictionnaire du cinéma, Robert Laffont, 1992, p. 261)
Il est, dans l’histoire du cinéma, quelques très rares films qui peuvent être considérés comme des œuvres matricielles. Sans aucun doute, Les Chasses du comte Zaroff fait partie de ce cercle très fermé, et cette position ne tient pas aux indéniables qualités techniques et artistiques déployées par les auteurs du film, pluriel sciemment utilisé car la réussite de Zaroff tient à un véritable travail d’équipe, même si l’apport de Schoedsack reste primordial. Un film, si sublime soit-il, si parfait sa mise en scène puisse être, n’en devient pas pour autant une œuvre matricielle. Il faut que le film fonctionne, frappe les esprits, c’est une condition sine qua non. Mais il faut avant tout que son sujet même possède une forme de simplicité, d’évidence qui puisse permettre à des générations d’auteurs de venir à leur tour broder dessus, de l’utiliser pour développer leurs réflexions philosophiques, morales, sociales ou plus simplement pour éprouver leur maestria de metteurs en scène. Si The Most Dangerous Game est une œuvre matricielle, c’est parce que son thème, un homme chassant ses congénères, contient la promesse de multiples et inépuisables variations cinématographiques. Le brio et l’intelligence de la forme étant le garant que ce thème soit transcendé et que le film puisse s’installer naturellement dans la mémoire collective..
On est happé, et ce quel que soit le nombre de fois où on a déjà vu le film, quel que soit le nombre de fois qu’on ait vu son thème repris ailleurs. Il y a quelque chose de magique et de difficilement cernable qui est ici en jeu, mais une partie de cette magie tient certainement au fait que regarder Les Chasses du comte Zaroff, c’est ouvrir un livre d’images qui nous ramène aux contes de fées de notre enfance : il y a le château, ses cryptes inquiétantes que l’on explore à la lueur d’une bougie, sa porte interdite gardée par un colosse ; il y a la sombre forêt et sa meute de loups haletants ; et bien sûr il y a l’ogre. Ce dernier est l’un des atouts du film et l’on sait depuis l’adage hitchcockien que plus le méchant est réussi, plus le film l’est. Leslie Banks s’avère excellent en aristocrate suave et inquiétant, rôle archétypale qu’il habite avec une grande conviction. Pour preuve de son talent, la scène où il présente sa salle des trophées à ses prisonniers a été écourtée par la RKO suite aux premières previews. [Olivier Bitoun - dvdclassik.com]
RAPPEL DE LA PROGRAMMATION DANS LE CADRE
DU FESTIVAL DES MAUDITS FILMS 2019
(Détails dans le programme spécial dédié)
Mardi 22 janvier, 20h
EL TOPO (Alexandro Jodorowsky)
(Interdit aux -12 ans)
Mercredi 23 janvier, 18h
SOLEIL DE FEU (Interdit aux -16 ans lors de sa sortie en salle – Larry Spiegel)
Samedi 26 janvier, 18h
LE MONDE PERDU (Irwin Allen)
Samedi 26 janvier : Double Séances
20h : GRINDHOUSE PINK FLAMINGO (John Waters)
(Interdit aux -16 ans lors de sa sortie en salle)
22h : CAPTAIN ORGAZMO (Trey Parker et Matt Stone)
(Interdit aux -12 ans lors de sa sortie en salle)
- Publié dans Partenariat FMF
- Soyez le premier à commenter!