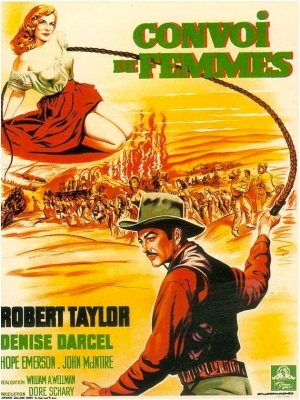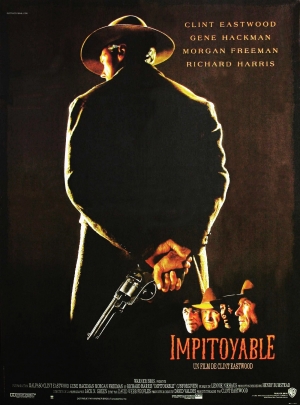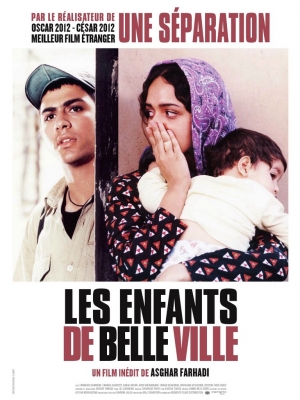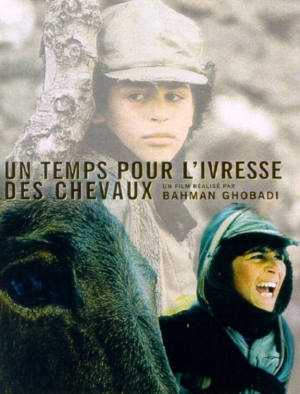Les 7 mercenaires
- Publié dans Vers l'Ouest
Toute l'Équipe du Ciné-club de Grenoble vous souhaite
une très bonne et belle nouvelle année.
2016 : Go West !
avec les quatre westerns du cycle "Retour à l'Ouest"
Premier départ
Mercredi 6 janvier 2016 à 20h
Cinéma Juliet-Berto (Place Saint-André, Grenoble)
Cycle " Retour vers l'Ouest " (1/4)
Les 7 Mercenaires / The Magnificent Seven
John Sturges (USA - 1961)
Oscar 1961 de la Meilleure musique de film pour Elmer Berstein.
Golden Globe 1961 de la révélation de l'année pour Robert Vaughn.
Le cycle "Retour vers l'Ouest"
"Au-delà du couchant, il y avait l'or du Nevada et de la Californie. Au-delà du couchant, il y avait la hache démolisseuses de cèdres, il y avait l'énorme tête babylonienne du bison, le chapeau haut de forme et le lit multiplié de Brigham Young, les fêtes et la colère du Peau-Rouge, l'air libre des déserts, la prairie illimitée, la terre essentielle dont l'approche fait battre le coeur plus vite, comme l'approche de la mer: en un mot, l'appel de l'Ouest."
Jorge Luis Borge
[cité par Jean-Louis Leutrat, in Le Western, quand la légende devient réalité, Découvertes Galimard, 1995, p. 13].
Brève typologie du western
La typologie la plus immédiatement repérable, celle qui fait dire aux détracteurs du western est qu’on y raconte toujours les mêmes histoires, est celle des situations dramatiques, voire même d’épisodes particuliers (on sait par exemple que la bagarre aux poings et le duel – gunfight – sont des épisodes si inévitables que leur eventuelle absense elle-même prend un sens). Les situations-types les plus fréquentes sont celles de l’itinéraire, - souvent d’abord errance qui finit par se transformer, au hasard d’une rencontre, en quête d’un sens ; de l’établissement de la loi et de l’ordre dans une ville livrée à la barbarie ; du conflit entre grands éleveurs et petits fermiers, passage d’une féodaité à une démocratie ; de l’affrontement entre l’armée et les Indiens (situation qui doit demeurer épisodique, puisque son omniprésence peut faire basculer le film du western vers le film de guerre, etc.
Les personnages relèvent également d’une typopolie, encore plus précise et restreinte (mais susceptible d’importantes variations). La figure centrale est celle du héros, caractérisé par un expert de la conquête de l’Ouest, avec le savoir qu’elle implique, à la fois sur maniement des armes, la survie dans les contrées sauvages, les mœurs indiennes, etc. Mais c’est aussi, plus profondément, une figure du peuple, au sens, en particulier, où le héros est spontanément du côté de la justice et du bon droit, prêt à prendre le parti des opprimés. En cela, le type symétriquement opposé sera celui du « méchant », du villain, emblème de la tyrannie et de l’injustice : l’affrontement final entre le héros et le villain sera le dénouement obligé de la situation.
Denis Lévy, L’art du cinéma, n° 5 (juin 1994) « Western ».
Les 7 mercenaires vs Les Sept samouraïs.
John Sturges revisite le chef-d'oeuvre d'Akira Kurosawa " Les sept samouraïs " et l'adapte aux circonstances relatives à la vie américaine, si bien que de l'intrigue originale ne reste que l'ossature, soit une lutte inégale et désespérée où des mercenaires mettent leur courage au service d'une cause qui n'est pas la leur.
Les règles du western n'en sont pas moins respectées, alternant les plans relatifs à la calme tranquillité du labeur paysan et aux soudaines et brusques explosions de violence. Beauté des paysages, détails de la vie quotidienne, bravoure des combattants, faciès de ces héros qui composent, chacun selon son style, un casting exceptionnel et photogénique ; oui, rien n'est laissé au hasard pour concocter une recette savoureuse qui, malgré son succès en salles, ne sera gratifiée d'aucun Oscar. Reste que Les sept Mercenaires est considéré de nos jours comme un film culte que l'on revoie toujours avec un égal plaisir. D'autant que la musique d'Elmer Bernstein contribue à l'imprimer dans la mémoire et à lui donner une ampleur supplémentaire.
Impassibles, taciturnes, tout en ayant chacun une personnalités différente, ces sept mercenaires tirent le film vers une sorte d'épure du western qui, quant à lui, opte pour l'unité de lieu et ne retient sur la pellicule que les temps forts de l'action. Le récit est donc rapide, très circonscrit, et bénéficie des paysages magnifiques de la sierra mexicaine, en même temps que d'une interprétation exceptionnelle. Au prix d'une rivalité qui fut grande sur le plateau, chacun des acteurs tire son épingle du jeu et il est vrai que de voir défiler Yul Brynner en ange exterminateur, Steve McQueeen et son désarmant sourire de beau gosse en intrépide justicier, James Coburn redoutable et impavide manieur d'armes en solitaire taciturne, Charles Bronson en généreux défenseur des causes perdues, Horst Buchholz en chien fou, Brad Dexter en arriviste est un régal pour le public. On peut même dire que nous avons en prime du scénario un défilé de "gueules " impressionnant.
[http://laplumeetlimage.over-blog.com/article-sept-mercenaires-john-sturges-82349564.html]