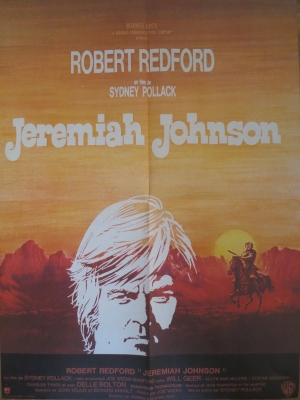Mercredi 6 décembre 2017 à 20h
Cinéma Juliet-Berto (Place Saint-André, Grenoble)
Cycle " Femmes d'Asie " (2/3)
Charulata
Satyajit Ray (Inde, 1964 - 117 mn)
xxxx
En quoi les émois d’une épouse délaissée tentée par l’écriture et l’adultère dans le Bengale de la fin du XIXème siècle peuvent-ils nous toucher en plein cœur ? Il suffit de regarder « Charulata », un des chefs d’œuvre de Satyajit Ray, pour tomber sous le charme. Le film, réalisé en 1964, nous livre le portrait subtil d’une femme en quête d’émancipation et la radiographie du mouvement des âmes dans le huis clos d’une maison, microcosme du monde. Le maître du cinéma d’auteur indien, amoureux de Jean Renoir et admirateur des néo-réalistes italiens, a été longtemps à lui seul un « continent » dans son propre pays, du fait du caractère protéiforme de son œuvre, avant de connaître la reconnaissance nationale et la notoriété internationale. Aujourd’hui, « Charulata », que son auteur lui-même considérait comme son plus beau film, nous revient, dans l’absolue modernité de son sujet et de sa forme.
Une mise en scène dans la pénombre des âmes
Ecrivain, scénariste, compositeur, Satyajit Ray, en véritable « homme-orchestre » sait ce que le cinéma doit aux autres arts : la littérature, la musique et la danse. Il sait aussi ce qu’il doit aux cinéastes qu’il a aimés : Jean Renoir, qu’il assista un temps sur le tournage du « Fleuve », aux environs de Calcutta, sa ville natale, Vittorio de Sica pour « Le voleur de bicyclette », dont la vision dans une salle à Londres fut déterminante. Il partage, en effet, avec les cinéastes européens, les néo-réalistes en particulier, ce regard humaniste, cette infinie attention aux êtres et à leurs aventures intérieures, que l’on retrouve dans « Charulata ».
Ici le visage de l’héroïne, tantôt saisi en gros plans fixes, tantôt en plans plus larges et mouvants, s’apparente à une plaque sensible dont la caméra capte les moindres frémissements, dont la musique, composée par Ray lui-même, transcende les sentiments à travers la variété thématique et la tonalité dominante. Pour donner à voir la perception du temps et la durée d’une transformation en profondeur, -la marche lente d’une femme à la découverte d’elle-même et l’effritement irréversible d’un couple-, le cinéaste invente sans cesse des mouvements d’appareil audacieux - travellings, zooms et superpositions de plans fixes- en une sorte d’harmonie imitative des états successifs de la conscience. L’évolution des lumières à l’intérieur de la demeure, ses variations du noir et blanc contrasté et chatoyant aux clair-obscur prégnants, crée ainsi une atmosphère de désenchantement qui gagne. Et le visage de Charulata en larmes, terrassée par le départ d’Amal, penchant sa tête en bordure du lit, fait revenir l’image d’un autre visage, celui d’Henriette, juste après le baiser du séducteur dans « Une partie de campagne » de Jean Renoir : des lèvres entrouvertes, un regard douloureux qui se déplace vers un ailleurs et l’humidité de la joue sous la paupière perlée de larmes. [Samra Bonvoisin (cafepedagogique.net, 09 avril 2014].)]