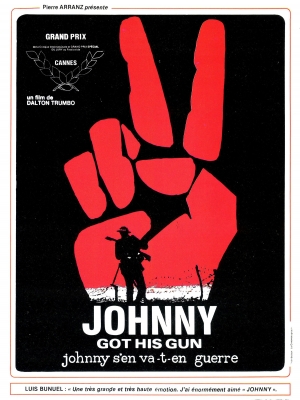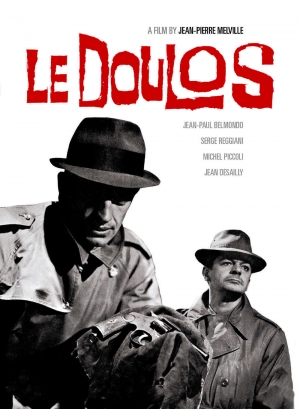Lubitsch : l’homme du cinéma pur (Alfred Hitchcock). Un prince (François Truffaut). Un géant (Orson Welles).
Lubitsch sur son film
Je considère Le ciel peut attendre comme une de mes œuvres majeures, car j’ai tenté alors de rompre, à divers égards, avec la formule traditionnelle suivant laquelle sont faits les films. Avant de mener à bien celui-ci, j’ai rencontré une certaine résistance, parce qu’il ne délivrait aucun message et ne visait aucun objectif en particulier. Le héros en était un homme qui ne s’intéréssait à rien d’autre qu’à avoir une bonne vie, sans avoir l’ambition d’accomplir quoi que ce soit, ou de réaliser quoi que ce soit de grand. Le studio m’aynt demandé pourquoi je voulais faire un film aussi dépourvu de relief, j’ai répondu que j’espérais faire connaître aux spectateurs d’un film un certain nombre de personnages, et que si le public les appréciait, cela suffirait pour faire le succès du film. Fort heureusement, il s’est trouvé que j’ai eu raison. De plus, j’ai montré un mariage heureux sous un jour plus authentique que cela se fait habituellement à l’écran, où cette sorte de mariage est trop souvent décrite comme une relation pantouflarde, ennuyeuse et sans éclat.
Herman G. Weinberg, Ernst Lubitsch, The Lubitsch Touch, Ramsay Cinéma, 1994, p. 183.
François Truffaut sur Lubitsch
« Donc pas de Lubitsch sans public mais, attention, le public n’est pas en plus de la création, il est avec, il fait partie du film. Dans la bande sonore d’un film de Lubitsch, il y a le dialogue, les bruits, la musique et il y a nos rires, c’est essentiel, sinon il n’y aurait pas de film. Les prodigieuses ellipses de scénario ne fonctionnent que parce que nos rires établissent le pont d’une scène à l’autre. Dans le gruyère Lubitsch chaque trou est génial. […]
Si vous me dites : « Je viens de voir un Lubitsch dans lequel il y avait un plan inutile », je vous traite de menteur. Ce cinéma-là, c’est le contraire du vague, de l’imprécis, de l’informulé, de l’incommunicable, il ne comporte aucun plan décoratif, rien qui soit là « pour faire bien » : non, du début à la fin, on est dans l’essentiel jusqu’au cou.[…]
Sur le papier, un scénario de Lubitsch n’existe pas, il n’a aucun sens non plus après la projection, tout se passe pendant qu’on le regarde.
François Truffaut, Les films de ma vie, Flammarion, 1975, p. 73.
La présentation du film par J.P. Coursodon et B. Tavernier
Un homme et une femme sont en train de valser au son de La Veuve joyeuse, à l’écart de leurs invités. Ils fêtent leurs noces d’argent et revivent quelques moments heureux du passé. L’homme a mené une vie de plaisir, trompant plusieurs fois sa femme, mais ce soir, une amitié amoureuse et attendrie les rapproche comme s’ils découvraient un sentiment nouveau. La femme, plus mûre, regarde son mari avec sérénité et semble vouloir lui cacher un secret pour ne pas l’effrayer. La caméra recule dans un long travelling à la grue et le commentaire nous apprend que, six mois plus tard, la femme va mourir. Vers la fin du film, un mouvement inverse accompagnera, toujours au son de la même valse, la mort du héros, qui nous sera aussi cachée. Ces deux séquences clés se trouvent dans la deuxième partie de Heaven Can Wait, œuvre miraculeuse qui tient de la confession et du testament. Comme son héros, Lubitsch récapitule sa carrière, fait revivre ses souvenirs. Toute sa vie, il a exalté, de manière plaisamment amorale, le plaisir, tourné en ridicule les institutions sociales, les interdits. Et il regarde son héros, cet homme qui ne veut pas vieiliir, qui lutte avec des efforts ridicules, touchants et tragiques, pour goûter un peu de joie, sans s’apercevoir de la gravité que peut contenir un instant de bonheur, de la fragilité d’un souvenir. Et Lubitsch ne peut s’empêcher d’admirer cet homme, de lui donner raison au moyen d’une pirouette dramatique qui n’est peut-être que le visage de la pudeur : Dn Ameche préfère suivre une jolie fille au purgatoire plutôt que d’aller au ciel. Film somme, Heaven Can Wait est à Lubitsch ce que Le Carrosse d’or est à Jean Renoir, une réflexion d’un artiste sur son œuvre et un aboutissement de cette œuvre. Oscillant avec une délicatesse rare, à l’intérieur d’une même scène, entre l’émotion pudique, la satire farceuse et la chronique souriante d’une justesse qui sera inégalée, cettte œuvre en dit plus long sur les rapports entre un homme et une femme que tous les pensums d’Antonioni dont se gargarisent nos intellectuels. Cette valse nostalgique venait juste après To Be or Not to Be, percutante satire du nazisme, d’une lucidité et d’une audace inouïes pour l’époque, qui firent crier au scandale les conformistes de toutes tendances (le même accident est arrivé à son disciple Billy Wilder, avec les admirables Kiss Me Stupid et One Two Three) qui se complaisent, eux, dans la propagande larmoyante.[…]
[J.P. Coursodon, B. Tavervier, 50 ans de Cinéma américain, Omnibus-Nathan, 1995, p. 655]
Gene Tierney sur le travail avec Lubitsch
" Lubitsch était un petit bonhomme aux cheveux noirs et raides, coiffés sur le côté, avec un cigare dans le coin de la bouche. Il avait été l'un des grands du cinéma européen et avait fait tourner Greta Garbo dans le classique Ninotchka. On voyait en lui le maître absolu de la comédie raffinée et sophistiquée. Mais sur le plateau, c'était un tyran, le plus exigeant des réalisateurs. À la fin d'une scène - poursuit-elle, que nous avions travaillée de midi à cinq heures pour obtenir le résultat désiré, j'étais au bord des larmes à force d'avoir entendu Lubitsch me crier après. Le lendemain, je suis allé le trouver, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit : - Mr. Lubitsch, je suis bien décidée à faire de mon mieux, mais il me sera vraiment impossible de rester sur ce tournage si vous continuez à me crier après. - On me paye pour ça, aboya-t-il. - Exact, dis-je, mais moi, on ne me paye pas assez pour en entendre autant! Après un silence tendu, Lubitsch éclata de rire. Depuis lors, nous nous sommes entendus comme larrons en foire."
Le cinéma de Lubitsch
Lubitsch, juif allemand né à Berlin, exilé à Hollywood au début des années 20, acteur puis réalisateur, muet et parlant, avait emmené dans ses valises un savoir faire et des bonnes manières. La fameuse « touch » justement. Et c'est quoi alors ? Un sens du rythme et de l'ellipse qui donne à chacun de ses films des allures de formule 1 qui refuserait de s'arrêter au stand. Pas de temps mort chez Lubitsch. Ses breuvages se boivent cul-sec. Le ciel peut attendre, nous dit d'ailleurs l'un de ses plus fameux cocktails. Il y a le raffinement, on l'a dit. Les personnages bien mis sont les vecteurs de satires sociales souvent cruelles. Pour la tendresse, on repassera. « La délicatesse c'est une peau de banane sous les pieds de la vérité ! » entend-t-on dans Sérénade à trois. Lubitsch avait du goût, au point de prendre un certain Billy Wilder - le futur réalisateur de Certains l'aiment chaud ou Sunset Boulevard - comme co-scénariste. Les dialogues comme les situations offrent des gags volontiers burlesques qui éclatent comme des bulles de champagne. Pas de tartes à la crème. De la tenue que diable ! Les ouvrages de Lubitsch sont des chef-d'oeuvres d'horlogerie que les exégètes comme les amateurs s'amusent à démonter pour comprendre comment c'est fait. Voilà pourquoi il reste encore aujourd'hui la référence absolue en matière de comédie. To be Lubitsch or not Lubitsch, that's the question. C'est (juste) une question de feeling et surtout d'une (grosse) dose de génie (avec ou sans cigare !).
Thomas Baurez [L’Expess, 25 août 2010]